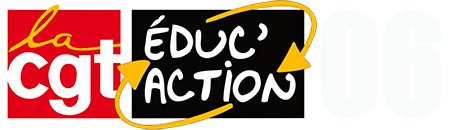Tribune Le dernier des Pangolins
Chroniques
Se faire violence, 6 avril 2023

Je suis un pangolin, arrivé dans une valise en 2017, à Roissy Charles de Gaulle. Je suis un réfugié domestique. J’habite Contignies-lès-Mormeilles, commune périphérique, dans une meulière avec jardin, propriété de ma famille d’adoption. Simple observateur de la vie de ces humains qui peuplent ce cher pays de leurs enfances, j’avoue avoir de plus en plus de mal à comprendre les mots et les flots de violence qui traversent la société.
J’entends parler de Max Weber, d’Hannah Arendt et de tant d’autres penseurs, chercheurs, intellectuels, essayistes convoqués par des politiciens en mal de punch line.
D’ailleurs, l’illustre sociologue doit fulminer dans sa tombe, en réalisant que sa notion de « monopole de la violence légitime » fait l’objet d’interprétations, de contresens et d’usages abusifs dans la bouche de sinistres ou de vizirs déchus qui défilent dans l’hémicycle ou sur des plateaux télés.
Cette « violence légitime » n’est plus qu’un slogan justificatif des violences policières reprochées au pouvoir en place. Preuve en est, le sinistre de l’intérieur lançant, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale : « La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C’est vieux comme Max Weber ! »
Je suis un pangolin qui apprend, s’étonne, prend des notes, déterre articles, analyses, regards. Pour les croiser, les confronter. Je suis un fourmilier des choses de la vie. Hier, en parcourant le papier d’un journaliste, je réalise que, quand Weber écrit « l’État est cette communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé […] revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime », il décrit juste un processus, mais ne spécifie pas que les forces de l’ordre seraient toujours dans leur bon droit.
La violence n’existe pas chez les pangolins. Nous sommes aussi agressifs que notre dandinement bipède le laisse supposer. Nous sommes complètement édentés, nous sommes définitivement solitaires et notre mécanisme de défense consiste à nous rouler en boule et à attendre que le danger se dissipe. C’est ce que feraient tous mes congénères si, par malheur, ils étaient pris dans une queue de manif, place ou square ou esplanade de la République. S’ils entendaient une sommation, s’ils recevaient illico presto une pluie de grenades sur les écailles,
s’ils devaient amortir le pas lourd et botté des caparaçonnés de l’Ordre triomphant, qui descendraient de leurs engins motorisés pour fouler la foule, sans retenue. Les terribles schémas sécuritaires remis en oeuvre – nous avions découvert cela lors des « Gilets Jaunes » – m’évoquent les jeux du cirque où des gardes prétoriennes, montées sur des chars aux roues parées de lames acérées, venaient achever la besogne, en massacrant des gladiateurs, forcés de s’entretuer pour les beaux yeux et le pouce dodu d’un empereur sociopathe.
Je suis un pangolin qui s’exprime mais, aux yeux de l’opinion publique, je demeure un vulgus manis. Dans notre société où l’apparence est reine, je suis, comme tous mes frères et toutes mes soeurs, victime d’un délit de faciès. Petits mammifères, mal connus, d’un abord pas très liant, on nous a vite assimilés à des meurtriers en série. Braconnés, exterminés pour notre chair, notre kératine, nous avons été accusés d’avoir provoqué les premières contaminations lors des vagues pandémiques de la Covid 19.
Quel paradoxe ! Nous appartenons à une espèce menacée par l’Homme qui est reconnue coupable, de manière expéditive, d’avoir porté atteinte à la survie de l’humanité. Nous rappelons, à cette humanité-là, que « le monde viral hébergé par les animaux est sans limite ». Nous sommes, par la force des choses, les symboles du droit de l’urgence sanitaire.
Arendt parle de l’élément d’imprévisibilité totale que nous rencontrons à l’instant où nous approchons du domaine de la violence. Quand la violence pandémique (et ce qui en a découlé) a fait irruption dans notre société – tant qu’elle demeurait dans des contrées lointaines, elle ne nous gênait pas ou peu- avec ses cortèges de morts, de malades, de statistiques terrifiantes, il a fallu trouver un coupable. La violence médiatique a pris alors le relais, laissant ainsi exsuder des consciences, la menace de l’imprévisible. Dans un monde stable et régulier, cette violence et toutes les autres, ont introduit le dérèglement et le chaos.
Ce mot « violence » semble alors nommer une situation comparable à l’état de nature où règne la guerre de tous contre tous, selon la philosophe hobbesienne.
Cet élément d’imprévisibilité ne se retrouve-t-il pas aujourd’hui, au coeur de l’idée d’insécurité, souvent associée à celle de violence ? L’insécurité correspondant à la croyance ou au sentiment que l’on peut s’attendre à tout, que l’on ne peut plus être sûr de rien dans la vie quotidienne. La montée du thème de la violence dans les discours politiques ou dans les préoccupations de l’opinion publique est le symptôme des problèmes sociaux et des peurs qui trouvent ainsi à s’exprimer.
L’actuelle réforme des retraites n’illustre –t-elle pas le manque de capacité et de volonté des sommets de l’État, d’obtenir un consentement par des voies pacifiques, non brutales ? Plutôt que d’exprimer une quelconque légitimité, les violences policières d’aujourd’hui traduisent en fait, un déficit criant dans l’action de l’exécutif.
« C’est parce que le pouvoir ne parvient plus à se légitimer par des méthodes plus subtiles qu’il imprime au régime une dérive prétorienne, en ne laissant, entre lui et la société, que les forces de l’Ordre. »
On combat la violence, on l’analyse mais l’erreur serait de la nier. Un monde pacifique reste illusoire. Pour Jean-Michel Longneau, la violence est une donnée anthropologique, elle est intrinsèque à l’être humain. La nier revient dès lors à ignorer une part de soi-même, et dès lors à se condamner à ne jamais pouvoir l’apprivoiser. Prendre conscience de la violence qui nous habite, de même que de celle qui nous entoure, est nécessaire pour apprendre à lui faire face.
Le pouvoir en place s’échine à fermer tous les canaux possibles par lesquels la société peut l’alerter, le contrôler, l’amener à des compromis. Comme si, entre l’obéissance et l’émeute, il n’y avait de place pour rien.
Je veux citer Camus : « l’Homme au moment où il rejette l’ordre humiliant de l’oppresseur, rejette en même temps son état d’Homme opprimé. Désormais il veut être traité en égal… En même temps que la répulsion à l’égard de l’intrus, il y a dans cette révolte, une adhésion entière et instantanée de l’homme à une certaine part de lui-même. »
Lors de la parution de son ouvrage consacré aux Changements dans la violence, Yves Michaud rappelait : « Nous découvrons toujours la violence comme scandaleusement et absolument inédite pour la simple raison que nous vivons notre vie à nous et pas celle des autres, que c’est à nous que les choses arrivent et pas à un spectateur flottant au-dessus de l’histoire et qui en aurait vu d’autres. C’est pourquoi il y a toujours un air d’apocalypse à l’irruption de la violence dans une paix dont la durée se mesure à notre expérience. Il est vrai aussi que les formes de la violence changent avec l’évolution des moyens techniques et les inventions de l’imagination meurtrière. »
Voilà, j’ai épuisé mes notes. Je me prépare à partir pour une énième manif.
On lâche rien !