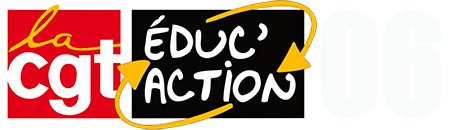Une histoire ordinaire

(Ce texte a paru dans le Café Pédagogique du 25 novembre 2026)
J’ai grandi dans une famille bourgeoise. Mon père médecin, ma mère au foyer, parfois débordée, mais toujours aimante. Les autres femmes, celles de la télé, du supermarché, ou toutes celles qui se trouvaient derrière un guichet : des « salopes », des « poufiasses », des « pétasses mal baisées ». J’ai eu trois frères, ils étaient toujours la priorité, pour l’école, le sport, pour la musique et les autres activités, sauf peut-être pour les vêtements. Les vêtements, pour une fille, c’est important. De belles robes brodées que je malmenais. J’y fourrais la fin de mes repas, je les déchirais à grimper dans les arbres ou sur mon vélo, je les embourbais sur un terrain de foot un peu détrempé. Mes frères se moquaient, mes frères m’embêtaient, mes frères me protégeaient. Mes frères, je les idolâtrais. J’étais déjà tiraillée entre ce monde de garçons, auquel j’aspirais, et celui des filles dans lequel on me rangeait.
À 17 ans j’ai voulu m’échapper. J’ai choisi les seules études qui, à proximité, n’existaient pas. J’aimais les maths et les sciences, mais les mecs qui se la racontaient, je ne supportais pas. Alors j’ai choisi le contre-pied : un peu d’art, un peu d’air, je pensais bien m’émanciper. La réalité m’a vite rattrapée. Au bout de quelques années, le concours d’enseignant·e, et bientôt un premier enfant, un garçon. Lorsque j’attendais le second, encore un garçon, j’en étais persuadée, Tom, Luc ou peut-être Olivier. La gynéco a annoncé : « Tout est parfait ! C’est une fille… Vous devez être contents, c’est le choix du roi. » Nous sommes sortis et je me suis effondrée, je venais seulement de réaliser, en m’apprêtant à mettre au monde cette enfant, toutes les injustices, toutes les violences auxquelles j’allais l’exposer. Cette vérité m’a dévastée.
Alors seulement j’ai commencé à m’opposer. J’ai cherché les responsabilités, dans l’éducation ça veut juste dire chargée de mission ou responsable de la formation. En outre, j’ai refusé systématiquement toutes les tâches bénévoles, qu’à un homme, on n’aurait jamais assignées. Prête à saisir toutes les opportunités, j’ai changé de lycée, et de simple prof d’arts appliqués je suis passée à prof d’atelier. C’est toujours le même métier, mais en lycée professionnel, on se sent plus respectée, plus valorisée. Physiquement aussi, j’ai changé, j’ai repris le sport, d’abord pour être forte, pour me muscler, puis la compétition. J’ai progressé, il m’est même arrivé de gagner. J’ai réduit mon temps de travail, pour pouvoir tout concilier, et c’est comme ça que j’ai commencé à réellement m’émanciper.
À 40 ans pourtant, j’ai craqué. Malgré ces petites victoires, la fissure était toujours là, elle n’avait jamais cessé de s’élargir, prête à m’engloutir. C’était l’été, on venait de passer le printemps confiné. Ma fille fêtait ses 10 ans, elle allait bientôt entrer au collège… 10 ans, c’est l’âge que j’avais, l’été avant d’entrer au collège, quand j’ai été la victime des abus sexuels de mon oncle. Pas de violence, pas de cri, pas de contrainte.
Juste ses mains, ses mains partout, dans ma culotte, sous mon pyjama. Ses mains et ses doigts, là où même moi je ne les mettais pas. « Mais qu’est ce que tu fais ? » j’ai demandé. « Oh, tu sais, c’est juste des câlins, c’est parce que je t’aime bien. » Ce soir-là, le plus horrible de tous, après qu’il m’ait léchée, partout, longtemps, lentement, ce soir-là, quand il s’est relevé, a mis mes mains sur son sexe, et m’a demandé de m’approcher. Ce soir-là quand je lui ai dit que j’avais froid, que je voulais rester sous mon drap, il s’est arrêté. Comme s’il suffisait de demander. Et si je l’avais fait, dès la première fois, n’aurait-il jamais continué ? S’en est-il jamais préoccupé ? Je ne le savais pas, et je ne le saurais jamais. À moi de vivre avec ça.
J’ai passé les premiers jours, les premiers mois, à ne pas savoir ce qui s’était passé. À ne pas vouloir, à ne pas pouvoir en parler. Dans mon vocabulaire d’enfant, il n’existait pas de mot pour ça. Les années suivantes, j’ai essayé d’oublier. À 20 ans, comme je n’y arrivais pas, j’ai voulu en parler. À un garçon plus vieux que moi, qui a tout de suite paniqué et dont je n’ai plus entendu parlé. À des copines de soirées qui ont pensé que c’était juste un truc inventé, pour me faire remarquer. Plus tard, j’ai pensé à la loi, persuadée pour plusieurs raisons, que dans mon cas elle ne s’appliquait pas. Quand mon oncle est décédé, j’avais déjà plus de 25 ans, et j’ai pensé que cette histoire aussi allait être enterrée. J’ai fait de mon mieux pour ne plus y penser, encore quelques années, mais ça n’a toujours pas marché. Un jour où je n’y pense pas, ça n’existe pas !
Les premières personnes à qui j’ai été capable de l’expliquer, ce sont mes enfants. Parce qu’ils deviennent grands, parce que je ne veux pas, que jamais, ils n’aient à subir ça, que jamais ils ne commettent ça. Et si, malgré tout, ça devait arriver, je veux qu’ils sachent le dire, qu’ils puissent m’en parler. À ma mère, à mon père je reste encore incapable de me confier, peut-être que ça viendra.
S’il m’a fallu des années pour comprendre que ces violences ne sont pas séparées, mais bien les deux faces d’un même mode de domination, c’est grâce à toutes celles qui ont osé parler avant moi. Grâce à elles, j’ai pu trouver les mots, comprendre ce qui m’était arrivé. Le mépris des femmes que mon père crachait devant sa télé, les insultes que tant d’autres ont proférées, peut-être même sans les penser vraiment, sont les vecteurs d’une société qui considère les femmes comme inférieures, comme des objets. C’est ce terreau qui nourrit les violences. Dans ce climat de mépris ordinaire, les abus deviennent possibles, presque banals. Mon oncle n’était pas un monstre isolé. Il était le produit d’un système qui nous apprend, dès l’enfance, que le corps des femmes et des fillettes ne leur appartient pas vraiment. C’est ce modèle qu’il faut corriger, et nous en portons la responsabilité collective.
Alors à mon tour, je parle. Bien sûr, le dire aujourd’hui, l’écrire, fait partie de ma thérapie. Mais je n’écris pas seulement pour moi. Si j’écris aujourd’hui, c’est parce que chaque jour j’y pense, souvent dès le matin. Je me demande pourquoi je n’en ai pas parlé, si j’aurais pu, si j’aurais dû. Je me demande s’il a fait d’autres victimes ? Combien auraient pu être épargnées si seulement je l’avais dit ?
Quand j’entre au lycée, je traverse la cour puis les couloirs, je regarde les visages de mes élèves, de mes collègues. Combien ont connu ça ou pire encore ? Combien le subissent en ce moment même ? Combien prodiguent ou acceptent au quotidien cette violence ordinaire ? Combien partagent ce secret, qui transforme les femmes en objets, les fillettes en jouets, qui détruit les rêves et les projets, les remplace par le calvaire et les cauchemars ? Je ne peux pas les compter, mais je sais qu’ils et elles sont là, quelque part dans ces couloirs. Je les croise sans les voir, parce qu’on ne sait jamais à qui se confier. À un ou une collègue ? À un ou une camarade ? Un infirmier ou une infirmière scolaire ? Un surveillant ou une surveillante ? Un ou une prof comme moi ? Comment trouver cette personne de confiance qui ne connaît pas votre intimité familiale, qui ne vous jugera pas, qui saura vous écouter sans minimiser ? Une personne qui sache quoi faire, concrètement. Quelqu’un·e qui est passé par là.
Aujourd’hui, je n’y arrive plus. Je ne veux plus me contenter de souhaits et de bonnes intentions. Je veux que nous agissions, non seulement dans les circulaires et les textes officiels, mais aussi dans les faits, dans la réalité quotidienne de chaque établissement, de chaque salle de classe, de chaque cour de récréation. Je veux que nous formions tous nos personnels sans exception : enseignant·es, CPE, AED et AESH, agent·es et personnels administratifs, en plus des personnels médicaux et sociaux. Que nous apprenions le respect dès le plus jeune âge, que nous expliquions le consentement avec des mots simples et clairs. Que nous enseignions la loi, que nous fassions connaître les droits de chacune et de chacun. Que nous, les adultes, sachions repérer les signes, accueillir la parole sans la juger, accompagner les victimes, alerter les bonnes personnes, et surtout stopper les violences avant qu’il ne soit trop tard. Je veux que l’école devienne enfin le refuge qu’elle promet : un rempart contre l’ignorance et l’asservissement, contre la violence et le harcèlement. Un lieu de paix et de solidarité, un lieu d’égalité et de liberté.
Marion Dupré
Co-Secrétaire Générale de la Cgt-Educ’Action 06